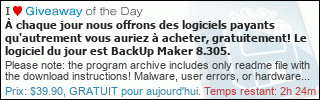11 avril 2009
10 août 2008
29 juillet 2008
Beijing-2008 ou Femmes nues au Mah jong

Dans cette peinture à l'huile du peintre chinois habitant à Toronto LIU Yi刘溢, quatre jeunes filles jouent au jeu chinois traditionnel du Mahjong. Cette peinture a, depuis avril 2006, fait énormément de bruit sur Internet en Chine. Elle fut initialement intitulée "Femmes au Mah jong". C'est lors de sa première exposition, en mars 2006 à New York, que l'artiste l'a renommé "Beijing-2008" du fait du symbolisme qui en ressort. "Les Olympiades sont appelés par les Occidentaux 'Les Jeux',et le Mah jong, est aussi un 'jeu'" explique LIU. Aujourd'hui, cette peinture est beaucoup plus connue sous son deuxième nom "Beijing-2008"en Chine.
Source :chine-informations.com
12 juin 2008
Le baccalauréat fête ses 200 ans cette année
ÉDUCATION Le baccalauréat fête ses 200 ans cette année
Le baccalauréat, né le 17 mars 1808 par un décret de Napoléon 1er, se déroulait à l'origine sous forme orale et surtout en grande partie en latin, avant de connaître moult évolutions tout au long de 200 ans d'une histoire mouvementée.
> Probablement venu du latin «bacca laurea», «baie de lauriers», le mot de «baccalauréat» signifie aujourd'hui, pour plus de 500.000 jeunes, le passage à l'âge adulte, la sortie de la scolarité.
> Lors de sa première session, en 1809, seuls 30 candidats sont reçus, après s'être soumis à trois quarts d'heure d'une épreuve orale de latin, grec, français et philosophie (cette dernière en latin aussi), conduite par des professeurs d'université, explique Philippe Marchand, maître de conférence émérite à Lille III.
> Le corpus des savoirs à maîtriser porte alors sur l'ensemble du programme depuis la 6e.
> L'histoire et la géographie s'y ajoutent en 1820, les maths et la physique en 1821. En 1840, les candidats, qui ne sont encore que des garçons (Julie-Victoire Daubié est la première femme ayant obtenu le droit de se présenter au bac à Lyon, en 1861), sont désormais plusieurs milliers à se présenter (près de 3.000 reçus en 1830). Ils passent une épreuve écrite de version latine, en deux heures, qui détermine leur admissibilité.
Apparaît alors le «bachotage», permis par la publication de «mémentos» et, par extension, «s'ouvrent dans tout le royaume des boîtes à bac+, qu'on appelait des fours à bachot», précise M. Marchand.
> Jusqu'ici sanctionné par une seule appréciation (très bien, bien, assez bien ou mal), le système de notation est transformé en 1854. Le jury dispose de trois boules, une blanche (positif), une rouge (moyen) et une noire (négatif), et en dépose une dans une urne à chacune des huit épreuves désormais en vigueur. Huit boules blanches se traduisent par la mention très bien et une boule noire suffit pour être ajourné.
> Notre notation de 0 à 20 n'apparaît qu'en 1890-91.
> L'effervescence des réformes éducatives de la IIIe République et ses débats entre les partisans des humanités classiques, appuyées sur le latin et le grec, et les promoteurs d'une éducation sans latin mais avec plus de français, de langue vivante et de sciences, secouent encore l'organisation du bac à la fin du siècle.
> Scindé en deux parties en 1874 (une en fin de 1e, une en fin de terminale), il s'obtient à partir de 1880 sans le «discours latin», préparé et prononcé alors par tous les élèves, puis se sépare en deux bacs: le «classique» comprend toujours du latin et du grec pour tous, se divisant en deux séries (philosophie ou mathématiques élémentaires), et le «moderne», sans latin.
> Ce nouveau bac «moderne» répond à une telle attente qu'entre 1893 et 1904, on passe de 583 à 2.155 bacheliers.
> Jusqu'en 1945, de nouvelles séries apparaissent, de plus en plus de jeunes s'y essayent: 11.939 bacheliers recensés en 1935, garçons et filles, et 30.000 en 1948. «Les femmes investissent le baccalauréat surtout à partir de 1924, lorsque le programme des collèges et lycées de jeunes filles est aligné sur celui de l'enseignement secondaire masculin», explique M. Marchand.
> Plus récemment, l'histoire du bac se confond avec la massification des effectifs scolaires et des records historiques de candidats reçus: 82,1% de réussite en 2006 et 83,3% en 2007 !
> En 1963, les deux parties (1ere et terminale) sont abandonnées au profit, en 1969, des épreuves anticipées de français. Puis, en 1968 naît le bac technologique et en 1985 le bac professionnel.
source (AFP-Le Parisien)
Le baccalauréat, né le 17 mars 1808 par un décret de Napoléon 1er, se déroulait à l'origine sous forme orale et surtout en grande partie en latin, avant de connaître moult évolutions tout au long de 200 ans d'une histoire mouvementée.
> Probablement venu du latin «bacca laurea», «baie de lauriers», le mot de «baccalauréat» signifie aujourd'hui, pour plus de 500.000 jeunes, le passage à l'âge adulte, la sortie de la scolarité.
> Lors de sa première session, en 1809, seuls 30 candidats sont reçus, après s'être soumis à trois quarts d'heure d'une épreuve orale de latin, grec, français et philosophie (cette dernière en latin aussi), conduite par des professeurs d'université, explique Philippe Marchand, maître de conférence émérite à Lille III.
> Le corpus des savoirs à maîtriser porte alors sur l'ensemble du programme depuis la 6e.
> L'histoire et la géographie s'y ajoutent en 1820, les maths et la physique en 1821. En 1840, les candidats, qui ne sont encore que des garçons (Julie-Victoire Daubié est la première femme ayant obtenu le droit de se présenter au bac à Lyon, en 1861), sont désormais plusieurs milliers à se présenter (près de 3.000 reçus en 1830). Ils passent une épreuve écrite de version latine, en deux heures, qui détermine leur admissibilité.
Apparaît alors le «bachotage», permis par la publication de «mémentos» et, par extension, «s'ouvrent dans tout le royaume des boîtes à bac+, qu'on appelait des fours à bachot», précise M. Marchand.
> Jusqu'ici sanctionné par une seule appréciation (très bien, bien, assez bien ou mal), le système de notation est transformé en 1854. Le jury dispose de trois boules, une blanche (positif), une rouge (moyen) et une noire (négatif), et en dépose une dans une urne à chacune des huit épreuves désormais en vigueur. Huit boules blanches se traduisent par la mention très bien et une boule noire suffit pour être ajourné.
> Notre notation de 0 à 20 n'apparaît qu'en 1890-91.
> L'effervescence des réformes éducatives de la IIIe République et ses débats entre les partisans des humanités classiques, appuyées sur le latin et le grec, et les promoteurs d'une éducation sans latin mais avec plus de français, de langue vivante et de sciences, secouent encore l'organisation du bac à la fin du siècle.
> Scindé en deux parties en 1874 (une en fin de 1e, une en fin de terminale), il s'obtient à partir de 1880 sans le «discours latin», préparé et prononcé alors par tous les élèves, puis se sépare en deux bacs: le «classique» comprend toujours du latin et du grec pour tous, se divisant en deux séries (philosophie ou mathématiques élémentaires), et le «moderne», sans latin.
> Ce nouveau bac «moderne» répond à une telle attente qu'entre 1893 et 1904, on passe de 583 à 2.155 bacheliers.
> Jusqu'en 1945, de nouvelles séries apparaissent, de plus en plus de jeunes s'y essayent: 11.939 bacheliers recensés en 1935, garçons et filles, et 30.000 en 1948. «Les femmes investissent le baccalauréat surtout à partir de 1924, lorsque le programme des collèges et lycées de jeunes filles est aligné sur celui de l'enseignement secondaire masculin», explique M. Marchand.
> Plus récemment, l'histoire du bac se confond avec la massification des effectifs scolaires et des records historiques de candidats reçus: 82,1% de réussite en 2006 et 83,3% en 2007 !
> En 1963, les deux parties (1ere et terminale) sont abandonnées au profit, en 1969, des épreuves anticipées de français. Puis, en 1968 naît le bac technologique et en 1985 le bac professionnel.
source (AFP-Le Parisien)
25 mai 2008
L'origine de la fête des mères
L'origine de la fête des mères se trouve dans les sociétés anciennes dans lesquelles étaient organisés les premiers cultes dédiés à fêter les mamans. A l'origine, les Romains et les Grecs organisaient chaque année au printemps des cérémonies en l'honneur des divinités mères des Dieux, Rhéa et Cybèle. Chez les latins, réunies devant le temple de Junon, les femmes recevaient des cadeaux.
Cette tradition de fête des mères a perduré jusqu'au IVe siècle après Jésus Christ, date à laquelle le rituel des célébrations fut abandonné en raison de l'émergence de la religion.
L'origine moderne de la fête des mères : une fête made in USA !
La fête des mères moderne trouve son origine dans la suggestion d'un écrivain américain, Julia Ward Howe, à octroyer un jour de l'année aux mères pour les célébrer. Alors que chaque année elle organisait à Boston une journée de fête des mères, beaucoup pensèrent que ce concept était un peu trop original et l'idée de cette journée nationale consacrée à la fête des mères fut abandonnée jusqu'en 1907.
C'est au moment de la mort de sa maman, le second dimanche du mois de mai 1907, qu'Anna Jarvis demanda aux autorités de la Virginie de célébrer un office religieux en l'honneur de toutes les mamans à la date anniversaire de la mort de sa propre mère. La coutume s'implante très vite et, en 1914, le président Wilson déclare le second dimanche de mai comme étant la journée officielle de célébration de la fête des mamans.
En 1917, les soldats américains, engagés dans le conflit mondial et débarqués en Europe, importèrent la fête des mères sur le vieux continent.
L'origine de la fête des mères en France : un demi siècle de mise au point
Très vite les français prennent modèle sur les américains et en 1920, le ministre de l'intérieur proclame une journée pour fêter les« Mères de familles nombreuses ». La première guerre a fait des ravages parmi la population masculine et la fête des mères est l'occasion de récompenser la fécondité qui devient une vertu civique.
C'est le régime de Vichy qui institue la journée de la mère, sans aucune distinction par rapport au nombre d'enfants. La fête des mères s'adresse alors à toutes les mamans.
Cette fête laïque, très populaire en France, a été instaurée officiellement en 1950 par Vincent Auriol et fixée au quatrième dimanche de mai
De son origine à nos jours, l'histoire de la fête des mères a donc connu une longue évolution. Aujourd'hui, la fête des mères se célèbre le dernier dimanche de mai sauf lorsque celui-ci est également le jour de la Pentecôte. La fête des mamans est alors reportée au premier dimanche de juin. C'est actuellement l'une des dates païennes officielles des plus importantes et des plus populaires de notre calendrier.
Cette tradition de fête des mères a perduré jusqu'au IVe siècle après Jésus Christ, date à laquelle le rituel des célébrations fut abandonné en raison de l'émergence de la religion.
L'origine moderne de la fête des mères : une fête made in USA !
La fête des mères moderne trouve son origine dans la suggestion d'un écrivain américain, Julia Ward Howe, à octroyer un jour de l'année aux mères pour les célébrer. Alors que chaque année elle organisait à Boston une journée de fête des mères, beaucoup pensèrent que ce concept était un peu trop original et l'idée de cette journée nationale consacrée à la fête des mères fut abandonnée jusqu'en 1907.
C'est au moment de la mort de sa maman, le second dimanche du mois de mai 1907, qu'Anna Jarvis demanda aux autorités de la Virginie de célébrer un office religieux en l'honneur de toutes les mamans à la date anniversaire de la mort de sa propre mère. La coutume s'implante très vite et, en 1914, le président Wilson déclare le second dimanche de mai comme étant la journée officielle de célébration de la fête des mamans.
En 1917, les soldats américains, engagés dans le conflit mondial et débarqués en Europe, importèrent la fête des mères sur le vieux continent.
L'origine de la fête des mères en France : un demi siècle de mise au point
Très vite les français prennent modèle sur les américains et en 1920, le ministre de l'intérieur proclame une journée pour fêter les« Mères de familles nombreuses ». La première guerre a fait des ravages parmi la population masculine et la fête des mères est l'occasion de récompenser la fécondité qui devient une vertu civique.
C'est le régime de Vichy qui institue la journée de la mère, sans aucune distinction par rapport au nombre d'enfants. La fête des mères s'adresse alors à toutes les mamans.
Cette fête laïque, très populaire en France, a été instaurée officiellement en 1950 par Vincent Auriol et fixée au quatrième dimanche de mai
De son origine à nos jours, l'histoire de la fête des mères a donc connu une longue évolution. Aujourd'hui, la fête des mères se célèbre le dernier dimanche de mai sauf lorsque celui-ci est également le jour de la Pentecôte. La fête des mamans est alors reportée au premier dimanche de juin. C'est actuellement l'une des dates païennes officielles des plus importantes et des plus populaires de notre calendrier.
24 mai 2008
19 avril 2008
21 mars 2008
le printemps
Le printemps est l'une des quatre saisons des zones tempérées. Elle se place entre l'hiver et l'été.
Dans l'usage courant, on assimile le printemps aux mois de mars, avril et mai dans l'hémisphère nord et de septembre, octobre et novembre dans l'hémisphère sud.
De prin, premier, et temps, cette saison commençait autrefois l'année.
Astronomiquement, elle commence avec l'équinoxe de printemps et finit au solstice d'été. En météorologie, elle commence conventionnellement le 21 mars.
Dans le calendrier chinois, qui est lunaire, le printemps commence vers début février et se termine vers fin avril. La fête du printemps y coïncide avec le nouvel an : c'est le début des semences et d'une fête de deux semaines. Ce décalage d'un mois et demi environ par rapport à l'Europe continentale est dû au fait que les équinoxes et solstices se situent à mi-saison. On le retrouve notamment dans les calendriers traditionnels celtiques ou scandinaves.
Dans l'usage courant, on assimile le printemps aux mois de mars, avril et mai dans l'hémisphère nord et de septembre, octobre et novembre dans l'hémisphère sud.
De prin, premier, et temps, cette saison commençait autrefois l'année.
Astronomiquement, elle commence avec l'équinoxe de printemps et finit au solstice d'été. En météorologie, elle commence conventionnellement le 21 mars.
Dans le calendrier chinois, qui est lunaire, le printemps commence vers début février et se termine vers fin avril. La fête du printemps y coïncide avec le nouvel an : c'est le début des semences et d'une fête de deux semaines. Ce décalage d'un mois et demi environ par rapport à l'Europe continentale est dû au fait que les équinoxes et solstices se situent à mi-saison. On le retrouve notamment dans les calendriers traditionnels celtiques ou scandinaves.
Inscription à :
Articles (Atom)